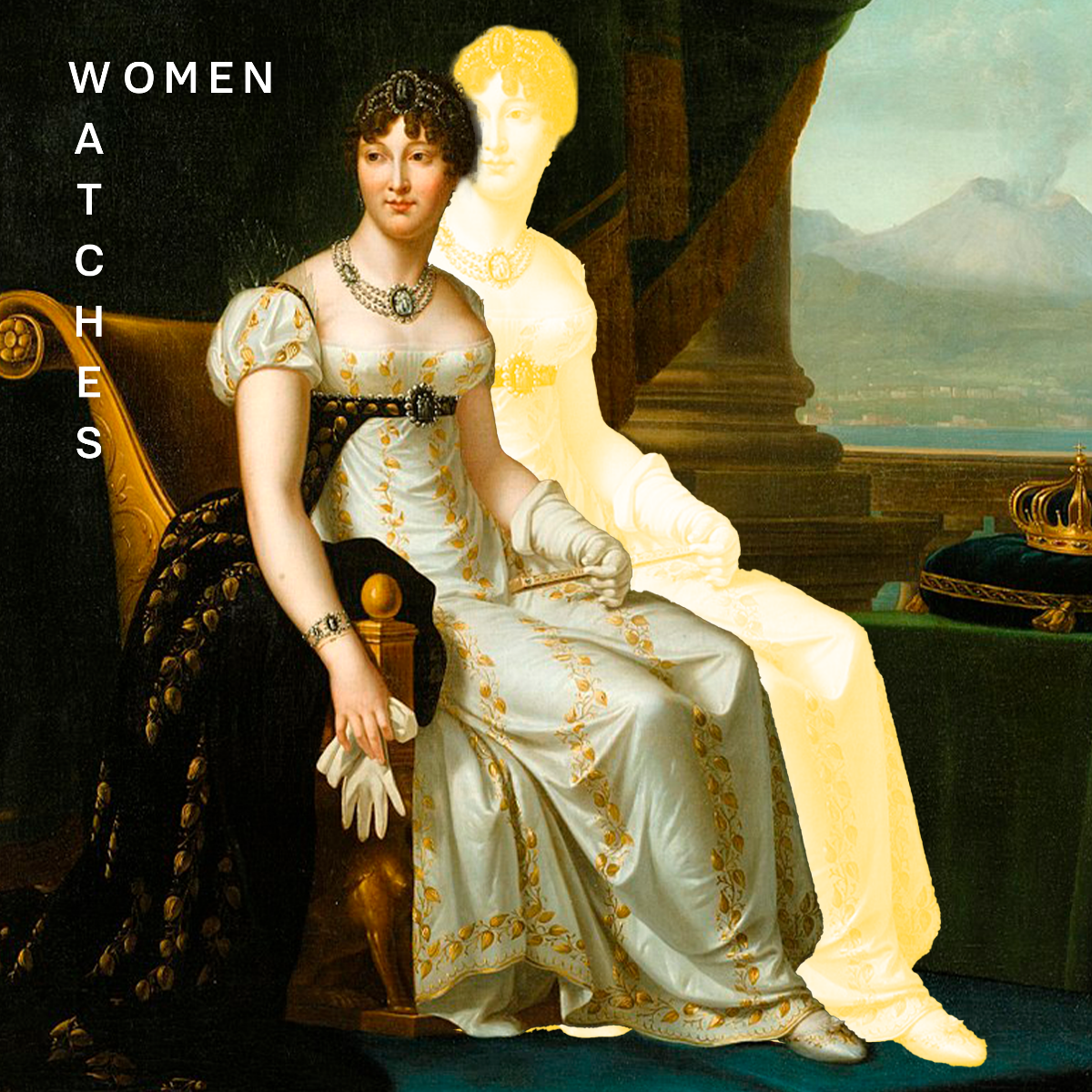À évoquer l’histoire horlogère, force est de constater que l’on s’intéresse à un univers exclusivement masculin. Jusqu’au xxe siècle, aucune figure féminine n’émerge du côté des professionnels qui ont fait progresser la science de la mesure du temps ou tout du moins qui ont laissé un nom dans cette véritable « aventure humaine ». À une exception près : Nicole-Reine Lepaute (1723-1788), astronome et mathématicienne française qui fut d’une aide précieuse lorsque son mari, Jean-André Lepaute, horloger du roi dès 1753, s’ingénia à concevoir des horloges astronomiques. Elle le seconda non seulement pour les calculs indispensables à la réalisation de ses projets mais également pour leur concrétisation.
C’est ainsi à Nicole-Reine Lepaute que l’on doit le calcul des tables d’oscillation du pendule nécessaire au Traité d’horlogerie rédigé par son mari, sans oublier ses contributions majeures aux travaux de l’astronome Jérôme de Lalande, lui-même associé au mathématicien Alexis Clairaut. Cette collaboration, lancée par son mari, allait notamment porter sur le calcul de la date précise du retour de la comète de Halley de 1759 ou encore sur celui de l’éphéméride astronomique publié dans La Connaissance du temps. Alexis Clairaut refusa néanmoins toute mention de Nicole-Reine Lepaute dans ses publications, contrairement à Jérôme de Lalande, qui sut apprécier à sa juste valeur celle qui, fait rarissime, fut admise à l’Académie des sciences de Béziers. Elle était « un maître plutôt qu’un émule », reconnaissait Jérôme de Lalande pour « s’occuper avec succès de calculs astronomiques ».